
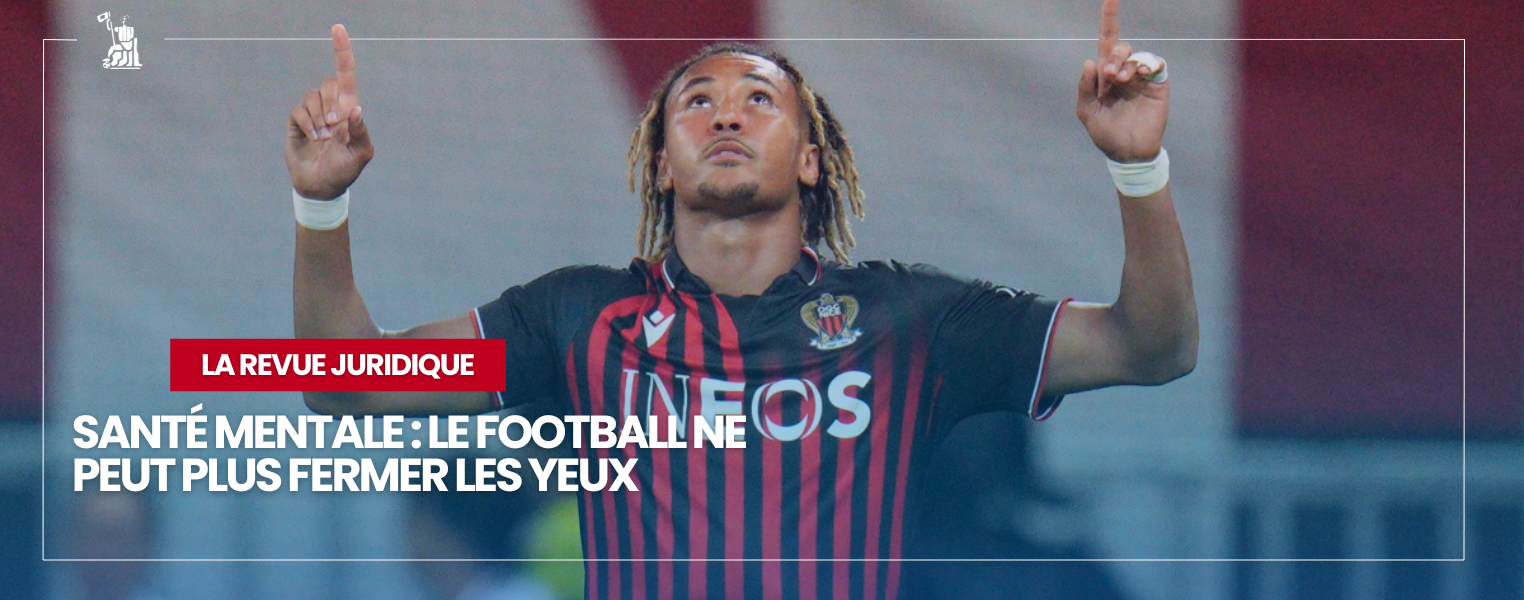
Il y a deux ans, le monde du football retenait son souffle. Le 29 septembre 2023, Alexis Beka Beka, alors joueur de l’OGC Nice, menaçait de se jeter du viaduc de Magnan. Derrière l’image du footballeur prometteur, se cachait une profonde détresse.
Aujourd’hui, à 24 ans, le jeune espoir du football français a retrouvé les terrains professionnels avec La Louvière (Belgique). Entré en jeu lors d’un match de Coupe de Belgique face à Heist, ce retour symbolise bien plus qu’une simple reprise sportive : il témoigne de la force du mental, du pouvoir du suivi psychologique, et de la responsabilité juridique des clubs face à la santé mentale de leurs joueurs.
L’article L4121-1 du Code du travail impose à tout employeur une obligation de sécurité et de prévention concernant la santé physique et mentale de ses salariés.
Dans le cadre du sport professionnel, cette obligation s’étend naturellement aux clubs : ils sont légalement tenus de protéger la santé mentale de leurs joueurs, au même titre que leur intégrité physique.
Le droit du sport français renforce cette approche.
Ces textes traduisent une évolution : la santé mentale n’est plus un sujet “à part” mais une composante du bien-être global de l’athlète, protégée par le droit.

Le cas d’Alexis Beka Beka fait écho à d’autres tragédies ou alertes vécues par des athlètes de haut niveau :
Ces cas soulèvent une question centrale : les clubs et fédérations respectent-ils réellement leur obligation de prévention des risques psychosociaux ?
Les institutions sportives ont un rôle déterminant à jouer.
Au-delà des obligations formelles, elles doivent mettre en place des dispositifs de soutien concrets : cellules psychologiques, référents santé, formations à la gestion du stress, ou accompagnement post-blessure.
En France, certaines fédérations — comme celles du rugby ou du handball — ont déjà instauré des cellules d’écoute et de prévention. Dans le football, la tendance émerge, mais reste encore inégale selon les clubs.
Les recommandations du ministère des Sports et de l’Agence nationale du sport (ANS) vont dans ce sens : renforcer la place du suivi psychologique dans les structures sportives, notamment pour les jeunes athlètes.

Le parcours d’Alexis Beka Beka démontre que le retour à la compétition n’est pas seulement physique.
C’est un travail de fond, rendu possible par un accompagnement adapté, la confiance de son entourage et la bienveillance d’un staff technique à l’écoute.
Son entraîneur, Fred Taquin, a résumé cette étape avec justesse :
“C’était inespéré, cela n’aurait pas dû arriver aussi tôt. Alexis est un joueur d’un niveau supérieur sur le plan technique. Il apporte de la magie.”
Préserver la santé mentale des sportifs ne relève pas uniquement d’un devoir moral : c’est aussi une question de responsabilité juridique et de performance collective.
Un athlète écouté, suivi et respecté dans ses limites devient plus stable, plus concentré et plus performant.
Les clubs ont donc tout intérêt à investir dans la prévention psychologique, au même titre que dans la préparation physique.
L’histoire d’Alexis Beka Beka rappelle que derrière chaque maillot, il y a une personne. Elle met en lumière une double exigence : humaine, parce qu’aucune carrière ne vaut la santé d’un individu ; juridique, parce que le club a une obligation de prévention et de soutien.
Le droit du sport doit aujourd’hui aller plus loin pour garantir que la santé mentale soit protégée au même titre que la santé physique.
Le retour d’Alexis Beka Beka n’est pas qu’un fait de jeu : c’est un signal fort adressé à tout le monde sportif — dirigeants, entraîneurs et institutions — pour qu’enfin, le mental devienne une priorité.